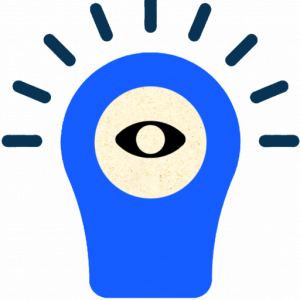Libreville, capitale du Gabon, vibre encore au rythme des décombres. Les récentes opérations de déguerpissement menées à Plaine Orety et dans la zone dite Derrière l’Assemblée ont réveillé de vieux démons urbains, entre justice sociale, cafouillage administratif et drames humains.
À première vue, l’État semble dans son droit. Réorganiser le tissu urbain, libérer des emprises illégales, redonner souffle à des projets souvent étouffés par l’occupation anarchique… autant d’objectifs louables. Mais dans le détail, le procédé laisse un goût d’amertume et soulève une série de questions douloureuses.

D’un côté, certains occupants ont été dûment indemnisés. Un procès-verbal de remise de chèques, une notification en bonne et due forme, puis un commandement de quitter les lieux ; la mécanique administrative a suivi son cours. Pourtant, beaucoup ont choisi de rester, convaincus que, comme tant d’autres avant, le projet ne verrait jamais le jour. Une méfiance forgée par des décennies d’abandons institutionnels.
De l’autre, une zone grise persistante : celle des victimes silencieuses. Ces familles locataires, parfois installées depuis des années, qui n’ont ni reçu indemnisation, ni information, ni accompagnement.

Jetées dans la rue, leurs biens broyés par les engins, leurs espoirs ensevelis sous les gravats. Elles paient le prix d’un conflit entre l’État et des propriétaires parfois peu scrupuleux, qui eux, avaient déjà encaissé leurs compensations.
L’affaire appelle à un sursaut de responsabilité. D’abord de l’État, qui doit mieux structurer ses actions, communiquer avec transparence et prévoir des mécanismes pour protéger les innocents. Ensuite des citoyens, appelés à cesser d’alimenter des zones d’ombre foncières, souvent à leurs propres risques.
Mais surtout, cette opération met en lumière une urgence nationale : celle de réconcilier développement urbain et justice sociale. Car derrière chaque maison détruite, il y a une vie brisée. Et un pays ne se construit pas sur des ruines humaines.